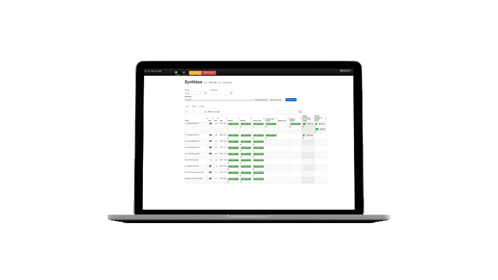Quels sont les 3 critères de la potabilité de l’eau ?
L’eau potable doit répondre à trois grands critères, chacun garantissant une dimension spécifique de la sécurité et du confort des consommateurs :
1. Critères microbiologiques : il s’agit de vérifier que l’eau est exempte de micro-organismes pathogènes, tels que les coliformes, les entérocoques, les E.coli ou encore les légionelles. Par exemple, la présence d’E.coli dans un échantillon est un indicateur direct de contamination, et peut rendre l’eau impropre à la consommation immédiate.
2. Critères physico-chimiques : ce critère regroupe de nombreux paramètres mesurables comme le taux de nitrates, les résidus de pesticides, les métaux lourds (plomb, arsenic), le pH ou la conductivité. Une eau présentant un taux de nitrates supérieur à 50 mg/l, par exemple, est considérée comme non conforme selon les normes européennes. Un pH trop acide ou trop basique peut aussi causer la corrosion des canalisations et altérer la qualité de l’eau.
3. Critères organoleptiques : ces paramètres concernent le goût, l’odeur, la couleur et l’aspect général de l’eau. Même si une eau est conforme sur le plan microbiologique et chimique, une mauvaise odeur ou un goût métallique peuvent entraîner une méfiance des usagers et inciter à ne pas la consommer. Par exemple, une coloration brunâtre liée à une présence de fer ou de manganèse peut susciter des inquiétudes, même sans risque sanitaire immédiat.
Ces trois critères sont surveillés en continu par les exploitants et régulièrement contrôlés par les ARS pour garantir la qualité de l’eau du robinet sur tout le territoire français.